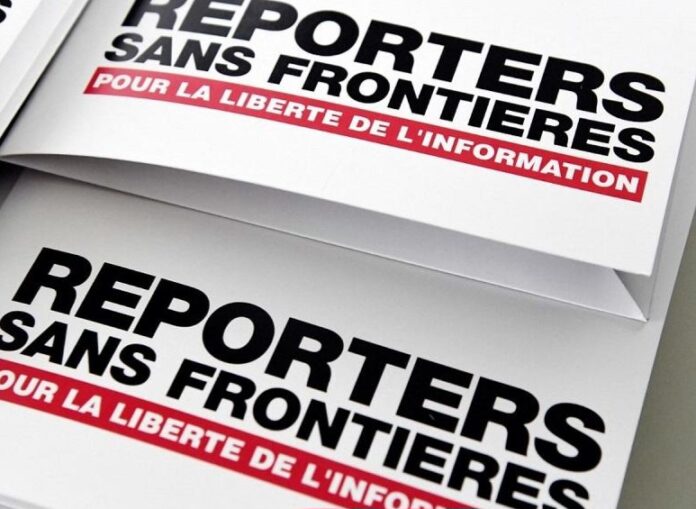La liberté de la presse connaît un déclin alarmant en Afrique subsaharienne, selon le dernier Classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF). Entre contextes de guerre, autoritarisme politique et crises économiques, les journalistes sont de plus en plus muselés. En 2025, les indicateurs révèlent une dégradation significative des conditions d’exercice du journalisme sur le continent.
RSF indique que 80 % des pays d’Afrique subsaharienne ont vu leur score économique chuter, ce qui fragilise davantage l’indépendance des médias. L’Érythrée conserve la dernière place du classement mondial (180e), confirmant son statut de « trou noir » de l’information.
Dans plusieurs pays touchés par l’instabilité, comme la République démocratique du Congo (133e, -10), le Mali (119e, -5), le Soudan (156e, -7) et le Burkina Faso (105e, -19), les médias sont pris en étau entre pressions politiques, violences armées et autocensure forcée. À l’est de la RDC notamment, les journalistes font face à une répression féroce dans un contexte de conflits persistants.
Guinée : une chute brutale et des journalistes sous pression
La situation en Guinée est particulièrement préoccupante, s’alarme RSF. Le pays perd 25 places et se retrouve à la 103e position avec un score de 52,53. Reporters sans frontières souligne que transition militaire en cours s’illustre par une hostilité marquée envers la presse, rappelant par exemple qu’en mai 2024, quatre radios et deux télévisions privées ont été « suspendues illégalement », après plusieurs mois de brouillages. L’organisation souligne que de nombreux sites d’information indépendants subissent également des restrictions d’accès.
Le rapport montre que les journalistes guinéens paient un lourd tribut : arrestations arbitraires, agressions, menaces de mort, surveillance étroite… « Ces atteintes se sont multipliées en 2024, dont la fin d’année a été marquée par l’enlèvement par des hommes armés du journaliste critique Habib Marouane Camara, toujours porté disparu. Les journalistes ayant une liberté de ton peuvent faire l’objet de menaces de mort, de menaces d’enlèvement et sont surveillés voire suivis par les autorités.
Certains sont contraints à l’exil. Ces actes de violence restent dans l’immense majorité impunis. Les arrestations de professionnels des médias sont aussi régulières. Le secrétaire général du principal syndicat de la presse, Sékou Jamal Pendessa, a passé plus d’un mois en détention pour avoir voulu organiser une manifestation pour la liberté de la presse », regrette RSF, qui déplore plus de 700 emplois perdus dans le secteur à la suite de l’interdiction de plusieurs médias critiques.
Concentration médiatique : un danger pour le pluralisme
Un autre phénomène structurel inquiète RSF : la concentration des médias entre les mains de personnalités politiques ou économiques proches du pouvoir. Ce phénomène, observé notamment au Nigeria (122e, -10), au Cameroun (131e), au Rwanda (146e), au Bénin (92e) et au Togo (121e), porte gravement atteinte au pluralisme et à l’indépendance éditoriale, selon l’organisation.
En Afrique du Nord, la Tunisie (129e, -11) illustre aussi ce recul, notamment en raison de la crise économique touchant les médias indépendants, devenus la cible régulière des autorités.
Dans ce tableau sombre, le Sénégal fait figure d’exception positive. Le pays gagne 20 places (74e) grâce à des réformes économiques amorcées par le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Mais il faut souligner que cette position de RSF n’est pas partagée par les organisations de presse du pays. Ces dernières ont récemment annoncé une série d’actions à mener, dont un sit-in devant le ministère de la Communication, pour dénoncer « une criminalisation illégale » de l’activité médiatique au Sénégal, où plus de 300 entreprises de presse sont menacées de suspension, voire de fermeture.
Le classement 2025 de RSF met en lumière une vérité préoccupante : la liberté de la presse en Afrique est menacée à la fois par les armes, l’argent et l’autoritarisme. Plus que jamais, les États africains sont appelés à garantir un espace médiatique libre, pluraliste et sécurisé, condition essentielle à toute démocratie viable.